06/12/2016
Pages arrachées
On reste loin des perdrix, à peine
danse-t-on, sans espoir, un pas de deux
auquel elles semblent consentir
entre pause et doux regard,
sans jamais se laisser
étreindre.
Leur crainte en apothéose,
en brassée puissante :
l’envol.
Et ce désespoir alors
de savoir être celui
qui toujours suscite
la crainte.
Aucun dieu ne renaîtra de la volonté capricieuse des hommes ou d’une mémoire incantatoire érigée comme un rempart. Partout les divinités se sont retirées dans les profondeurs du temps, dans un écoulement démesurément lent.
D’un cœur surnaturel. Qui a entendu sa dernière pulsation ?
Qui entendra la prochaine ?
Il ne faut que rompre avec l’autre cours du monde.
Et lire à nouveau les livres.
L’enfance, ces bordées d’anges aux petits pieds qui vont se blesser sans un mot, parce que rire ou saigner dans la forêt, parfois cela doit être pareil, on sème un peu de son sang, la mémoire mise en lambeaux de drapeau blanc dont on croit perdre les traces quand elles seront toujours là obstinément dissimulées, des traces comme des clous plantés au revers de l’esprit. Des goûts qui sont aussi des contournements d’autre chose. Des convictions pour calmer l’effroi. Parler pour ne rien dire.
La manière dont on échafaude l’architecture de soi est passionnante si l’on a assez de paix peut-être, d’intelligence pour l’examiner.
La rudesse surgie dans la fosse tropicale d’un atelier parisien. Le rouge gifle aux joues des repasseuses, qui font aussi les fleurs, les soldats.
Là-bas une silhouette maigre de jeune garçon s’éloigne sur la route, le pas décidé, un peu brusque, inégal même, comme s’il était sur le point de taper dans un caillou sans en trouver au bout de sa chaussure, les épaules sont batailleuses tandis que les bras traînent un peu en arrière, les paumes ouvertes dans une perpétuelle offrande au vent, un délice têtu que je connais bien, défiant la certitude qu’il n’en restera rien.
La silhouette s’arrête souvent et regarde le paysage. Les poings sont sur les hanches maigres. Le visage qui pointe légèrement sous la capuche pour un bref examen est dur et fermé. Je suis émue, mais il y a que je sais.
Je ne la rattrape pas trop vite, je goûte de toute mon âme l’instant qui va venir, sa manière depuis quelques temps de venir prendre mon visage dans ses mains pour embrasser mes joues avec une franchise charnelle que j’avais oubliée. J’imagine que je sens peut-être la pomme d’ambre et le cresson des fontaines, qu’il y a des étincelles sur mes joues et que sa curiosité mangera aussi cela. La vérité c’est que cette rencontre va de soi depuis le début puisque nous habitons deux collines voisines et que je cultive l’évidence du visage connu, le moins possible secourable, avec une semblable aridité. La saveur de Rose c’est d’avoir 90 ans et de les avoir menés jusqu’à cette entière brusquerie juvénile, caustique et sans appel.
J’ai appris que nous nous levons à la même heure. Nous humons sa soupe du jour.
Je dois toujours m’en aller, nous en convenons ; tout ce qu’il faut faire, ce genre de choses viennent ; après des bulles politiques et son effarement sans étonnement du devenir humain.
Demain si possible, quelque part sur la route pouilleuse au soulan* ou à la maison.
*[l'adret]
Le cabanon au fond du bois est pris par la végétation avec une lenteur sous-marine. Plus rien à sauver. Un consentement obstiné bruisse.
Le merle a gagné en profondeur, en une sorte de tessiture de rubis dans le noir, le moelleux aggravé d'un Cahors. Un obituaire chantant.
OUM CHALOUBA
Violent désarroi qui surgit après avoir croisé le regard de P., dont la photo revint sous mes doigts en cherchant une phrase dans un livre mince. Alors j'ai emporté bêtement les deux avec d'anciennes petites craintes d'oiseau qui ne saisit rien au déroulement du monde, puis voilà que la brume d'eau interdit pour l'heure d'aller remuer les buis pour y enfouir mon désarroi dans le parfum surabondant d'un passé qui se tenait encore à peu près (interdit de paix dans un monde aussi peu important qu'une tête d'épingle).
Tentative de penser qu'il faudrait prendre rendez-vous pour le lendemain lundi, cinq heures, celles du matin, et le ventre vide s'il vous plaît que nous ayons le plaisir de déjeuner ensemble en ayant très faim. Pas de destination prédéfinie, mais pile ou face pour un côté plutôt que l'autre. La pièce s'égarera dans l'herbe, il sera dit que ce serait donc à travers champs, cela dit non sans une intense émotion secrète car il ne tardera pas que nous nous donnions la main sur ce parcours semé d'embûches sous le peu de lumière de lune, et encore, demi-perle.
Sur cette photo, P., dix sept ans, empruntait à peine aux aînés. Les résultats n'étaient pas modestes mais il s'efforçait de l'être, ou plutôt il s'en foutait, il se laissait entraîner sur la scène pour commencer à jouer un grand rôle. Sur cette photo il pose devant la maison familiale, on aperçoit le jardinet qu'il n'a jamais consciemment regardé ; à l'arrière une bande de terre à travailler à laquelle il n'a jamais rien voulu comprendre. Lui, debout, ou plutôt campé durement, on ne peut pas imaginer combien sauf à avoir eu le loisir de s'appuyer sur son bras, les samedis sur la glace. Gentils conciliabules avec ce garçon troublé par la vie qui se dérobait sans cesse devant lui. Moi j'avais la constance du moineau qui aimait bien ses miettes, il me disait drôlement vieille branche pour qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous. Gentils conciliabules à l'entrée du parc : tu promets, tu ne m'as pas vu cet après-midi ? Il s'en allait par là, il rentrait à pied, les patins à glace pesant aux lacets en équilibre sur l'épaule. Mais il ne suffisait pas de rouler des mécaniques, il aurait fallu travailler. Un jour il partit plutôt remplir le rôle de l'uniforme, tout à coup, sûr de lui.
Bientôt la fourragère, éparpillée à Oum Chalouba.
16/11/2016
Perles d'eau d'Abyssinie
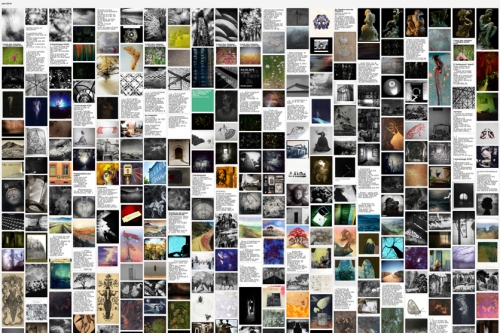
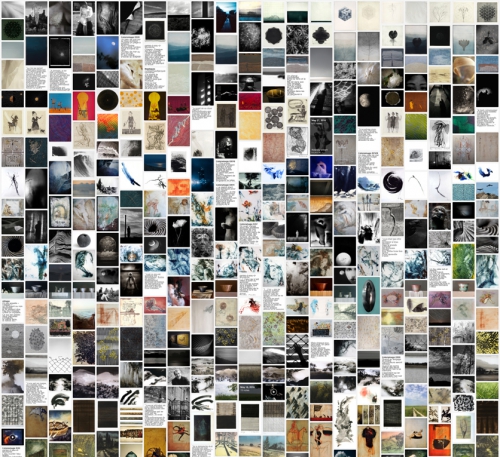
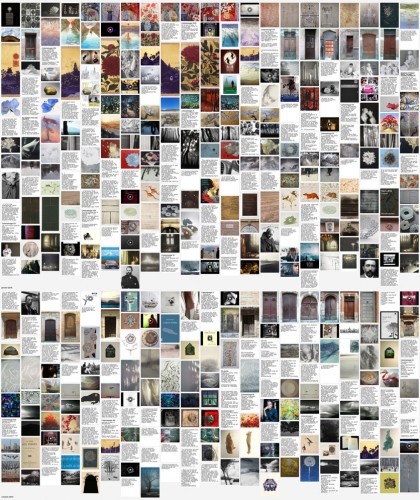
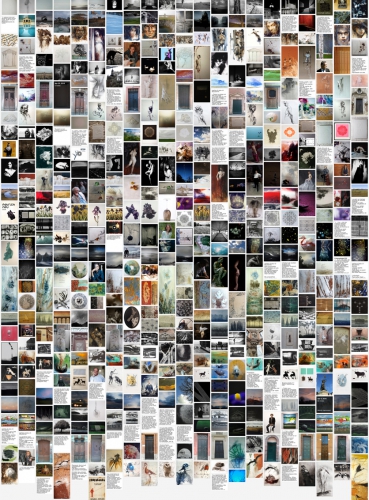
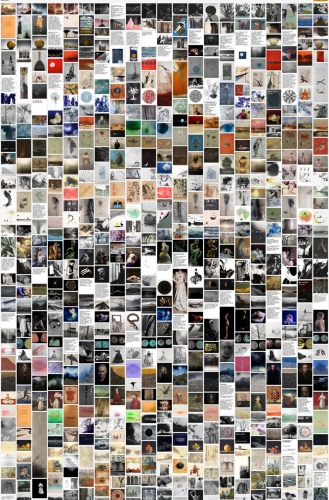
)* ευχαριστώ, γιώργος
PALIMPSESTE
« Il y a près d'ici la triste colonie française d'Obock, où on essaie à présent de faire un établissement; mais je crois qu'on n'y fera jamais rien. C'est une plage déserte, brûlée, sans vivres, sans commerce, bonne seulement pour faire des dépôts de charbon, pour les vaisseaux de guerre pour la Chine et Madagascar. »
Arthur Rimbaud aux siens, Aden, le 07 octobre 1884« On se retourne tout à coup /comme on voudrait fendre du bois /mettre le feu à tout / comme je l'ai mis voyez-vous /d'Obok à Lalibela. »
Manset, Obok
De passage à Obock, mais le sieur de Monfreid n'y est pas de quelques jours et personne ne sait me dire rien. J'ai fait le tour, rien, je ne vois rien encore dans ce désert de sable et d'eau qui ne soit inutile et abandonné, mais j'ai coutume de mon regard noyé quelques temps par mon esprit perdu. Je suis logée dans une petite chambre sans confort aucun (pas même une chaise) où mon peignoir de soie et ma brosse à cheveux en écaille ont tout à coup la saveur d'objets que j'aurais volés ou que j'aurais eus dans une autre vie. Hier j'ai trouvé dans un meuble bancal toutes sortes de revues pleines de ces images du monde lointain, écaille pareillement, soie et parfum dont j'ai le souvenir encore. Un vieil appareil photo, des précis de topographie, un dictionnaire de la langue amhariñña, et puis L'art de la guerre que j'ai pris avec moi ; j'en rapproche la lecture de l'horizon sec qui m'est donné ; j'attends donc dans cet état d'esprit.
LOIN LA CELLULE EN PLEIN CHAMP
Seize juin deux mille neuf, Lombez est juste un petit peu trop loin de tout encore et rassemble ses franges sous les couleurs fanées de ses crépis ou celles furieuses des coups de peinture, elle ne montre que des chats maigres et pouilleux, on l'entend à peine par une fenêtre ouverte. Les façades y semblent toutes s'être figées à la vue de l'amère déchéance en cours d'une bourgeoise muette qui se laisserait aller, peut-être encore un jour ou deux, ou dix ans, le temps que celui-ci ou celui-là décide de livrer la ville. Elle ne sait pas ce qu'elle va préférer, alors elle retient sa respiration et se fait toute petite. Car quel cours prendra alors le flux souterrain qui ne s'entend pas ? De quelles sources viendront les flots d'intérêts et où se déverseront les boues proprettes des intentions ? On recoudra l'hymen, on dotera les belles. Welcome. Les plus teigneux accrochés là enverront mille regrets menteurs aux cadets dispersés par le vent sauvage de la mobilité, mais longtemps partis aspirés par le monde ceux-ci reviendront, sans doute chassés par des vents contraires, ils reviendront en bataille vers ce cœur de petite ville pour la ranimer, la conquérir, peut-être même simplement y vivre en ayant apporté avec eux la sagesse qui se sera écoulée des plaies de l'arrachement. On sera peut-être loin de tout, et ce sera très bien. Tout le monde réapprendra à vivre ensemble, tous les jours, à longueur d'année ; la (bonne) volonté se conjuguera à l'impératif. Est-ce que le bon grain de l'humanité sera pour un temps égoutté de son ivresse ?
Le long des routes sinueuses il y a des herbes folles où se mêlent quelques avoines. Sur les riches routes des crêtes on pourrait toucher les toits des fermes allongées ou tapies entre les arbres. Collines, haies vives où explosent les fleurs des mûres, champs qui bordent de minuscules bois. Friches, assolement. À perte de vue des cultures, des champs, des collines. Bientôt tout cela peut-être à pied ou en vélo, il faudra attendre, pour voir plus loin, que notre énergie musculaire nous y porte (sinon tant pis mon ami, nous rêverons).
Sur les hauteurs de Lombez, par la vieille route qui mène à Saramon, un s'est lancé à planter du lin. J'en ai des images fugitives, le souvenir d'un ruban au matin, d'un bleu hollandais si frais ; à midi une nappe alourdie mais du violet le plus tendre ; ici des turquoises délaissées sur une mer céladon piquetée de délicats points de poste blancs qui chahutent, ce sont les papillons ; puis là sous le vent, sombrant au vert, comme une eau dormante un jour d'orage. Une flaque d'aigue-marine sous la lune.
Un jour, à mi-chemin, nous aurons comme ces moniales entrevues et laissées à leur paix, le même discret fou rire, cet intérêt détaché ; la simplicité soyeuse du choix d'un habit.
25/02/2016
Parfum 19*
Elle eut le geste parfum pour balayer l’instant d’avant. Elle pensa : c’est fou comme un parfum, pour ce qu’il recèle de gloire (c'est-à-dire qu'il est un agrégat – mais le mot gloire est plus juste pour dire cette accumulation dense de particules en nombre infini tout droit issues d’un passé sensuel) un parfum peut changer une femme, la faire passer de petite-fille embarrassée avec trois mots, jolie souillon dévouée aux marbres, pâle employée modèle, à conquérante en basse continue.
Ainsi elle aimait la première averse métallique qui éclaboussait de son alcool fort le désordre général, le temps d’être rejetée en arrière par cette lampée de rhum trop vert, à la puissance térébrante, mais nécessaire à une entaille verticale dans l’épais rideau du temps. S’ouvrait alors une plaine d’iris fauves fauchés en pleine verdure, soulevés de rhizomes, qu’elle parcourait avec l’ivresse des beaux malheurs et la bouche longtemps fourrée de bergamotes presque trop mûres, discrètement avide de se pourlécher les doigts de leur beau sucre orange, piquant de poivre, semé de fleurs, devenu fleuve narcotique frissonnant du même silence trouble que celui des végétaux sous la neige et du mot réséda, glissant aux pieds des arbres dont l’écorce lisse poudroyait au moindre souffle jusqu’à son lit de mousse, la secrète essence donnée dans les grandes forêts de chênes qu’elle avait connues pendant les mille ans de son enfance. (Et quitter la forêt, vêtue et résolue de pied en cape.)
* un parfum Chanel, N°19 créé par Henri Robert (1970)
12/01/2016
Papier bulle
Ton altérité comme un papier de verre parfois m'écorche, me blesse ou me malmène, alors de la voix — plutôt papier chiffon, tu essuies mes larmes.
Des heures de qualité papier de soie à ton exquise prévenance, en plaisir fou d'aimer certaines mêmes choses, joue contre joue (poudre et papier de riz) comme lorsqu’en visite au musée Guimet (papier chinois).
Je lis beaucoup sur papier vergé, j'écris un peu ici (tu sais comme je raye, papier mâché ou brûlé) et là cet écran ressemble plutôt à du papier bristol.
Je crois que tu m'aimes peut-être un peu trop (papier à en-tête) mais tu sais me donner chaque nuit (papier cristal) une jolie petite nuit (archives privées) et au matin, rosée soyeuse, le visage serein comme papier vélin.
POMMES ET RUBANS, LE NOUVEAU PÉRIPLE
Je suis d’un village où les pommes d'hiver qui venaient des jardins ne pouvaient pas être consommées en un bête geste gourmand, elles ne pouvaient pas être prises, croquées, sans y penser. Dans mon village, les pommes qui venaient de nos jardins étaient accompagnées de leurs rubans, qui désignaient pour nous à la fois le ruban de papier et la petite capsule de fer-blanc dans laquelle on le plaçait. Le tout pesait quelques grammes et mesurait à peu près cinq centimètres. En juin ou juillet on serrait les pommes dans un petit pochon de papier blanc pour protéger leur maturité, cela se faisait sur une semaine ou deux au gré de l'inspiration et des visites. L'inspiration pour écrire quelque chose sur le ruban et le déposer dans un des pochons que l'on serrait autour d'une pomme. Les visites de ceux auxquels on demandait aussi une pensée, un souvenir, un souhait ou un mystère à écrire et le confier à une pomme, et au temps. Tout cela a quelque chose à voir avec la maturation bien sûr, la méditation, les mots littéralement suspendus, l'empêchement à les reprendre, le dévoilement, l'accomplissement et le don (d'autres choses sans doute ; la trace).
Je me souviens du carton à chapeau en cuir cannelé, rouge passé parce que le cuir coloré avait fondu sous les mains qui le manipulaient à cet usage : recevoir tous les rubans à la récolte des pommes. Des instants, leurs images serties par le cerveau, pourquoi celle-là ? Trois fraises pour lesquelles je m'accroupis au jardin, me sachant prise par un regard, de dos ; un matin d'août après le violent orage de la nuit, la revue inquiète (moi, adolescente, inquiète pour la récolte des pommes, c'est fou) de tous les fruitiers et les précieuses pommes en robe blanche. L’époque d'un temps assez lent et désœuvré pour que le canal des sensations ait pu être percuté d'un seul soir violet et ses centaines de lampions blancs immobiles dans les pommiers. Le vieux dictionnaire et quelques mots brusquement nés à l'esprit : diorama, majolique, nacarat, ipséité, lesquels seront toujours empreints de l'odeur des vieilles pages, du regard qui cherche à tout prix à fixer leur sens dans le monde qui s'éteint avec le soir, entre les lignes presque effacées et celles du paysage familier, le verger dans l'ombre complète refermée sur les autres mots. Il me vient aussi l'image de ma petite main (presque la mienne d'aujourd'hui) disparaissant dans le fouillis des rubans légers à la recherche pleine d'espérance du ruban qui devait venir à moi, ses mots qui devaient parler à mon seul cœur puisque c'était mon tour, mon privilège de choisir un ruban, celui qui m'était destiné pensais-je de toutes mes forces. Ce genre de chose qui peut paraître folle n'a jamais quitté mon cœur. Je n'y joue pas, les terres éloignées de mon enfance ont été puissamment labourées et ensemencées et je jaillis toujours de cette irrigation.
Je me souviens aussi de ma volonté têtue et aveugle à tout le reste, des jours durant, d’avoir cherché à toujours me rappeler l'emplacement précis de tel ruban sur l'arbre parce que des mains on ne peut plus aimées l'avaient déposé là ; jusqu'à l'inquiétude d'une rentrée des classes ou l'attention tendue vers quelque chose d'autre - une lecture, un dessin à refaire, le souci de mon propre visage quelques jours de pluie successifs, et voilà le ruban qui s’était perdu, confondu parmi ses semblables, à en détester cette pratique stupide et cette attente du mot doux. Puis l'hiver venu, reprise par l'attente, oublieuse de mon mépris d'hier, incapable de me voir en cette sotte girouette des jugements comme des sentiments ; la proie de la tentation de l'inconstance ou la servante d'un élan mystérieux ?
Et puis un jour des rubans par centaines, trouvés dans une boîte tout en haut du placard de la chambre du mort, des centaines de rubans retrouvés, et dedans des mots. L'un en date du 05 juillet 1976 (« il fait trop beau pour que j'aille travailler, gros nuages à l'ouest, mais sans vent. Demain on fauche ! ») pour lire la très classique chronique météo de mon père, de celles que je craignais toujours d'attirer à mes mains plutôt que quelque belle phrase à la scansion propre à frapper mon esprit-tambour. Un autre d'une écriture inconnue, mais au délié inimitable de certaines lettres des élèves de jadis, je dirais donc une vieille amitié de la famille ou un voisin de la même génération, en date du 28 juin 1973, qui disait : « Mes chers amis, je vous remercie pour cet agréable moment avec vous. Toutes ces forces prises dans la permission de ne rien faire, grâce à vous j'ai appris quelque chose. Vous dites que l'hiver me répétera ce jour et sa leçon. On verra ! » (mais ruban non signé). Le troisième, signé Alice, en date du 21 juin 1978, complètement incompréhensible de prime abord : « Mirava il ciel sereno, Le vie dorate e gli orti, E quinci il mar da lungi, e quindi il monte. Lingua mortal non dice. Quel ch’io sentiva in seno. » Mais depuis j'ai trouvé, ce sont des vers de Leopardi : "je contemplais le ciel serein, les rues dorées et les vergers, là-bas la mer au loin, et là les monts, langue mortelle ne dis pas ce qu'au sein j'éprouvais". Je ne sais absolument pas qui est/fut cette Alice si cultivée qui passa en juin 78 et put citer de cette poésie que mon père détestait. Peut-être une promeneuse, séduite, je la verrais bien ainsi, par la joliesse de nos pommiers comme l'affabilité du terrien, son invitation comme il savait faire, envahissante, cette authenticité inimitable de l'homme de petite condition chez qui on fait une pause, auprès de qui on dépose le gros sac des prétentions humaines et leurs classes ; guère longtemps, l'aurait-elle pu, elle n'aurait pas pu ne pas se rendre compte de tout ce qui les séparait. Pourquoi vinrent à ma main ces vers de Leopardi ?
J'ai de beaux hivers à venir, pommes et rubans, à attendre quelques rubans datés et jamais découverts à l'époque. Pommes et rubans d'hiver comme apparition du monde pressenti alors. Ou je ne sais quoi. J'attends quelques rubans datés.

