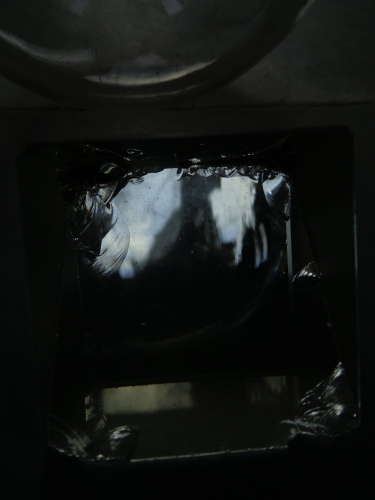12/04/2020
Le miroir intéressant
Photographies : ©Adèle Nègre
C’est un grand miroir poli de frais en Italie,
pour un cadre – un bois noir aux asphodèles –
aveugle orphelin depuis trop longtemps.
Dans la cour l’on s’appliquerait
– il fait beau c’est l’été –
avec du sel avec de l’eau,
voilà on s’appliquerait
à ternir le tain et le poli
car c’est ainsi comme
imiter l’haleine d’une foule de visages
passés pendant les siècles passés
et en un été, lentement
regagner toute la réserve du reflet
que le temps avait soufflée pour plus tard
– quinze heures, c’est l’hiver –
en manteau prune, dire que la beauté sourit
à la beauté sans importance.
Un miroir de poche ou une certitude.
N’y considérer que sa bouche, l’aile menue
encore muette sur elle-même avec un grand ciel
autour de soi, la cité rose dans un coin de glace,
une soif refusant l’ombre mais pas autre chose
non plus que deux mots urgents à dire, tout
retarde l’acquiescement à la convoitise
que l’on écrit ourlant ses lèvres de grenade
ou de cerise prise au sang, experte en trait
tiré du bouillonnant puits de l’amour
rue de la pomme, sous très haut porche.
La chair dénudée et les violettes c’est toujours
à pisse-fleurs, ce soulagement, la franchise
pour commencer, on reste bête jeune fille
curieuse de ses victimes puis de leur bourreau
prise au piège de l’air, plus que nécessaire,
toute l’eau enfuie mais le pubis reflété
comme dans un miroir – un instant,
puis dans un miroir sans tain, longtemps —
un empire éclairé par des rêves bleus.
Le miroir et le chevalet
… et dans un coin obscur, le poète
laisse fondre une amande sous sa langue
craignant le brusque craquement
du fruit sec, cette suggestion faite
au bouton de nacre, pur objet d’attention
mais comment faire sans troubler la scène.
Un simple bouton défaire, pour entrebâiller
la chemise – parce qu’il plaît – sur le cœur d’un homme.
Alors, l’écrire.
Au jeu de l’ennui sous le soleil frappant
miroir viser loin là-bas le rocher mussé
dans l’ombre des hêtres, d’un jeu innocent
l’adresse et l’illusion à franchir les avens,
portant dans l’ombre le soleil, soi, la fêlure
jusqu’à un coup ! reçu dans son œil, la brûlure,
tiré de là-bas, un coup encore, un éclat
de soleil sur l’épaule puis je sens la caresse
d’un doigt, dégrafe maintenant qui ose cela
sans franchir les avens ?
Une pièce de peau, un couloir sombre,
le pourchas de l’un à l’autre, l’œil gansé de noir
dans le miroir intéressant, Mata-Hari
prend tout son temps, se mire,
admire le charme émeraude des éclats
du fard-poudre tombé brillant sur sa joue,
sonde à coups de cils, décoche des regards
Glock GmbH en poche ma Joconde
destinée imaginaire, lointaine, glauque
l’œil, le geste, des secondes égrenées à dire
éteignent l’ombre derrière toi mais trop tard,
tu as été vue.
Dans le rétroviseur – autour, des voyageurs –
un regard pris par intervalle joue le buvard
amusé et patient sur mes yeux, pour quelle
curieuse lecture, syntaxe mêlée des chairs
en un disparate d’images, voyez plutôt
tout est dans le rouge monté à mes joues.
L’été c’est le souffle du loup
haletant avec raison tout près des peaux nues
pendant que dans l’ombre au miroir se joue
la mise à vif silencieuse
de la pertinence du monstre
femelle.
C’est un miroir antique, son trouble
trouvé vivant dans une tombe – quel gouffre,
la rêverie amène dans les couloirs du temps
pour saluer en soi les morts qui les bâtirent.
L’un est mort et nous sommes là dans sa maison
tous les miroirs ont été fermés au regard
tandis que l’on baigne dans son parfum, taisons
ce geste, qui ne sait plus être que ce geste
superstitieux mais solide comme un rempart
à l’épouvante de la mort notre reflet
en vie serait bien pire que dépourvu d’effet,
notre reflet serait refuge hors du silence
où la mort couche avec la mort.
I
L’on préexiste dans un visage ou l’autre,
c’est dit, c’est su, on a croisé tôt un regard
qui a fait de son souvenir le vôtre
instillant dessous l’image de soi
la pensée d’une ossature fantôme,
dans des traits féminins ceux disparus d’un homme,
vous avez ses gestes, le même air bouche close
faisant de vous le sujet de métamorphoses,
prisonnier de la glace cherchant en soi le sang
de qui fut assassin, fou du roi, don juan.
II
Vous avez ses gestes, diablerie, elle était morte
vous ne l’avez pas connue, sa fougue son maintien
transparaissent, dit-on, autour de vos yeux clairs.
Regarde ! Dans un miroir, l’existence est passée.
Cet héritage de l’air, la raison l’emporte :
votre lignée joue à cache-cache avec le temps
– tant qu’il y aura toute cette attention qui retient,
sue sang et eau pour vous, aime à perdre haleine.
Il y a sur le bitume une flaque qui ouvre
– on sait se pencher sur dix centimètres d’eau –
une faille, illusoire, fantastiquement vraie
surplombant un monde en miroir mais très étrange :
des cieux droits sans horizons, des cimes tombantes
une fraction de fenêtre, un tapis de tuiles en l’air
pour un voyage au centre de la terre.
D’où vient que l’on puisse s’en garder, s’éloigner
et laisser la place intacte, chanter les sirènes.
Débordement des eaux :
la surface du miroir est agrandie
et le ciel descend nous rendre visite.
Ensuite on chercherait des au-delà de marches
invisibles jusqu'ici,
au ras des fossés plein d'eau.
Avoir un subtil goût de barque
pour rentrer chez soi,
que l’œil invente aussitôt.
L’espion montra son visage au marchand de vin ;
celui-ci regardait les passants, corps visage
entre les bouteilles, chacun poursuivait un songe.
Celui de l’espion ne connaissait personne, là,
en ville, elle regardait le flot d’un œil, alerte
et gentille, les aguets étaient-ils inutiles ?
jusqu’à la silhouette – repérée par l’esprit –
saisie trop souvent dans les reflets des vitrines
livrant les signes, les rythmes, de son attention.
Il lui sembla sourire, boutique Alexandrine.
L’espionnée maintenant s’arrêtait très souvent
piquée par le charme du lointain intrigant
par où le poème devient plutôt un roman.
Elle traverse les miroirs.
C'est visible dans sa démarche, la tête haute
et l’œil éclatant. Sabre au clair féminin
dans vos regards appauvris de piété commerçante.
I
Les grands magasins sont tapissés de miroirs
où le tain est à l’opium Narcisse ma sœur
tiens-toi plus droite, marche un peu, évalue le prix
de la valse à un temps, deux constate le manque
trois ajoute un voile joue à Samothrace
c’est la victoire qui t’inspire
le succès à décrocher
pour la bataille contre le temps
qui n’a même pas encore commencé pour toi.
II
Ce coup d’œil vers l’arrière, un long regard sur soi
en femme de dos, dans le jeu des miroirs.
Cette femme, qui est-ce, on ne se reconnaît pas.
Entre deux essayages – cette banalité –
des langues troubles parlent lèchent montent en flammes
contre l’esprit étranger à son corps retourné.
À l’inconnue habillée, on fait grâce de juge
en soi assez d’obscurité, passons, et puis
jamais l’on ne s’éloigne, qu’y a-t-il à trouver ?
Mais à son nu, de dos dans les miroirs de l’alcôve,
le regard sort d’une jungle intérieure
s’attarde longuement sur le beau fauve lisse
que se déchirent d’évidence
Corot, Ingres et Velázquez.
Il est des miroirs cruels, ils vous guettent
dressés au mur comme des méchancetés
et puis en enfilade, pour dupliquer l’espace
s'ouvrant champ de vision du reflet du reflet.
L'illusion du regard qui vous guette, qui veut quoi ?
la grandeur du décor, la poupée qui convient ?
– à passer dans ce champ de tir, briqué à mort ?
Forcément méjugé, erratique, tremblant,
avoir le goût très sûr, revenir en arrière,
passer par la petite porte.
Quand l’enfantine découvrit le miroir
un jardin était dans la maison
une petite-fille devant elle
prit peur et se retourna.
(Merci Adèle...)
03/10/2016
L'automne
En forêt
L’on croit aimer les couleurs automnales
quand c’est le toit de la forêt,
ce temple,
l’été
d’un vert
qui était trop vaste.
De sa défaite alors, les fruits aimés.
Les fruits trop mûrs, les arbres creux *
Jour d'octobre, un automne présent et dernier. J'ai vu un cerisier peint par Seurat : une feuille verte, une feuille rouge, une feuille bistre, une feuille mousse, une feuille grenat, une feuille jade, orange brûlée, topaze, absinthe, maïs, céladon, carmin, malachite, fleur de soufre, orpin de Perse, alizarine, anis, citrouille, lichen, garance, impérial, cuivre, rouille, roux, rubis, paille, lie de vin, sang, ocre rouge, terre de Sienne, terre d'ombre... Puis un pommier peint par Egon Schiele, un vieux pommier décharné qui étendait au chaud soleil ses courtes branches devenues osseuses, il avait le même air désolé qu'à Vienne mais d'adorables pommes rouges et nombreuses l'égayaient. Les longues tiges brouillonnes des framboisiers portaient des oiseaux et quelques fruits séchés, image vue dans un livre d'enfant trop tôt fermé. Un potager redevenu sauvage, son arrosoir proprement renversé, les branchages tressés, sur tout cela la neige tombera et une pie pourra s'y poser. Parterre chamarré de feuilles d'or, les jardins de Klimt qu'il ignore. La maison des rêves d'enfant devenue un cloître inventé où dérouler d'Anselm Kiefer les fils dorés et ceux de fer, de feu ; ma vie saupoudrée de fleurs blanches et grises ; y méditer ce que je ne sais pas penser. Le tilleul pour les cendres du futur mort, la dentelle à ses poignets, le vin en cristal, sa nature morte. Et tout ce qu'il ignore, ce qu'il ignore... Le ciel était de vase bleue** dans lequel j'ai perdu mes chagrins.
* "C'est un parc où vont les bêtes et quelqu'un s'en souvient peut-être. Les fruits trop mûrs, les arbres creux, c'était le verger du bon Dieu" Manset, 1975
** Manset, 1976